L’éphémère est le thème de la 24e édition du Printemps des poètes qui se déroule chaque année en mars. L’éphémère, c’est ce qui ne dure pas. Brièveté de l’instant, du geste, de l’émotion, mais aussi brièveté de l’expression. Ça vous fait penser au haiku ? Vous avez raison, c’est la plus connue des formes courtes de poésie. Mais il y en a d’autres. Pour mieux les apprécier, essayez-les !
- Pourquoi s’imposer des contraintes d’écriture ?
- La brièveté poétique est universelle
- Le haïku japonais
- Règles de composition du haïku
- Le haiku français, cent ans de passion
- Le haiku contemporain
- Le ghazal persan
- Sophistiqué
- Populaire
- Le Ghazal contemporain
- Le sijo coréen
- Quelques sijo
- La daina lettonne
- Le landay afghan
- Pour aller plus loin
Pourquoi s’imposer des contraintes d’écriture ?
Atteindre la brièveté poétique nécessite des efforts de contorsion mentale, mais si vous voulez développer votre écriture créative, c’est un objectif qui s’atteint plus rapidement qu’écrire un roman, non ?
La poésie à forme fixe est une source d’inspiration infinie des ateliers d’écriture, friande des formes à contraintes. Ces contraintes stimulent l’imagination, développent l’effort et procurent un sentiment d’accomplissement et de satisfaction.
Du côté du poème, ces contraintes permettent de créer des liens inédits entre images et émotions, en plus d’insuffler des sonorités et du rythme. Bref, de la musique sans instruments.
La brièveté poétique est universelle
La brièveté poétique existe partout, des izlan berbères aux englyn gallois, en passant par les hain-teny malgaches. Les règles de composition diffèrent d’une culture à l’autre dans le ton, les thèmes, les rimes, les répétitions.
En termes de longueur, les poèmes courts, toutes origines confondues, dépassent rarement la quarantaine de syllabes ou pieds, qu’ils soient répartis sur deux (landay afghan, ghazal persan), trois (sijo coréen, haiku japonais), quatre (rubaï persan, épigramme français, pantun malais, daina lettone) cinq lignes ou vers (limerick irlandais, tanka japonais).
Le haïku japonais
Dix-sept syllabes. C’est le haiku japonais qui remporte la palme du plus bref poème au monde, même si ses concurrents ne sont pas loin, avec 22 syllabes pour le landay afghan et 30 pour le sijo coréen.

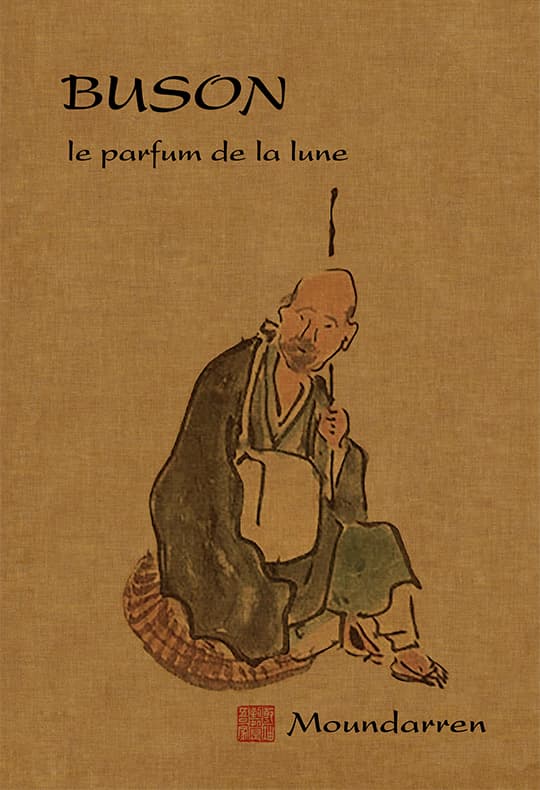

Règles de composition du haïku
Le haiku s’écrit en trois vers de 5, 7 et 5 syllabes. Dans sa forme la plus classique, il fait invariablement allusion à une saison (kigo). C’est un instantané, l’expression d’un moment d’observation de la nature et du monde qui nous entoure.
Les haïkus s’écrivent souvent en groupe (kukai) et en série. Dans les recueils de haiku classiques comme ceux de Bashô ou Buson, on peut lire des dizaines de poèmes s’émerveillant sur les fleurs de cerisiers.
Bien qu’il n’y ait rien à redire sur les innombrables haikus célébrant la beauté des cerisiers en fleurs, ils se déclinent aussi sur d’autres tons. Il suffit d’ouvrir une anthologie de haiku japonais classiques pour se rendre compte qu’ils peuvent aussi être largement humoristiques ou grivois … tout en respectant les règles de composition !
Quel est le con qui est allé
Takarai Kikaku (1661–1707)
pisser
sur cette neige fraîche
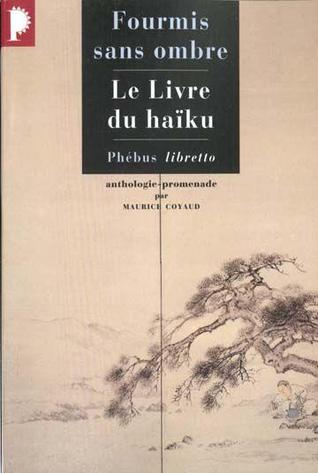

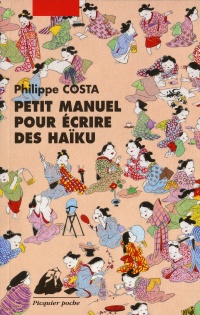
Le haiku français, cent ans de passion
Introduit en France vers le début du 20e siècle, le haiku a vite suscité l’engouement d’amateurs de haiku, appelés haijin, qui se réunissaient en clubs de kukai, puisque dans la tradition commencée par Bashô, les haikus s’écrivent, se commentent et s’améliorent en groupe. Quelques uns de ces premiers haikus français ont été rassemblées dans l’anthologie Au fil de l’eau suivi de haikai : les premiers haikus français 1905-1922, de Paul Couchoud, éditions mille et nuits, 2004.
Avec Cent phrases pour éventails parus en 1926, Paul Claudel n’a donc pas été le premier à en écrire, mais sa notoriété a introduit le haiku à un public plus large.
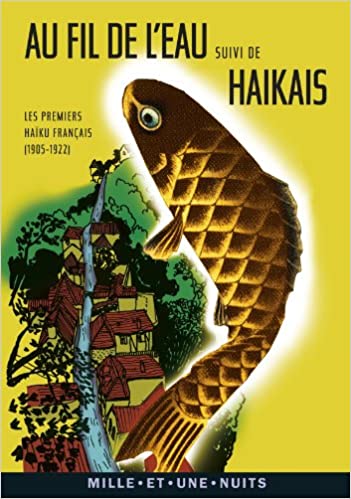

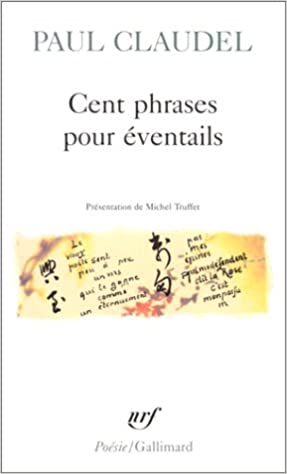
Le haiku contemporain
Côté américain, ce sont les écrivains Beatnik qui ont popularisé le haiku dans les années 60. En 1966, Diane Di Prima est la première à publier son recueil, sobrement appelé Haiku. Dans Clochards célestes, Jack Kerouac raconte que le poète Gary Snyder l’a introduit au haiku lors d’une promenade en montagne, juste avant que ce dernier s’installe au Japon.


Côté francophone, il existe une Association francophone de haïku depuis 2003. Elle a été fondée par les poètes Dominique Chipot, Daniel Py et Henri Chevignard, publie la revue Gong et deux anthologies par an, organise des ateliers d’écriture et la journée du haiku chaque année en octobre.
déménagement –
Dominique Chipot
abandonner le marron
planté pour ma fille
Membre de l’association, la Québécoise Jeanne Painchaud écrit, publie, partage et suscite le gout du haiku depuis plus de 30 ans. Ses haikus ont même été primés au Japon (concours du Mainichi Daily News), et certains de ses plus jeunes haijin ont gagné des prix dans la catégorie enfant du même concours. Elle a d’ailleurs écrit un album d’initiation au haiku pour les enfants, Mon été haiku, illustré par Chloloula et publié en 2021 aux éditions Druide.
Dans tes lunettes de soleil
Jeanne Painchaud (1er prix, Concours Mainichi, section internationale, Tokyo, 2013)
mon reflet sur la plage
deux jambes un ventre
Dans Pourquoi les non-japonais écrivent-ils des haiku? Alain Kerven, haijin de longue date, a voulu comprendre pourquoi l’attrait et la pratique du haiku dépassent largement les frontières nippones. Il publie également des anthologies de haiku sur des thématiques d’actualité, comme l’anthologie Haiku et changement climatique : le regard des poètes japonais.
Bonne nouvelle!
il desserre le nœud
qui s’est formé en lui
Alain Kervern

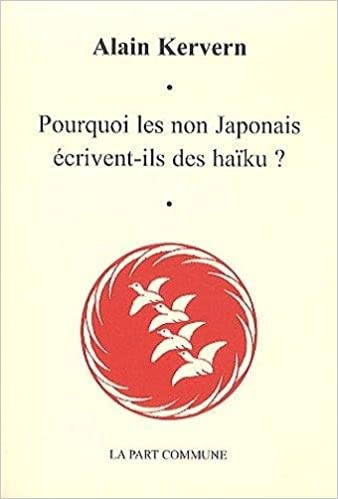

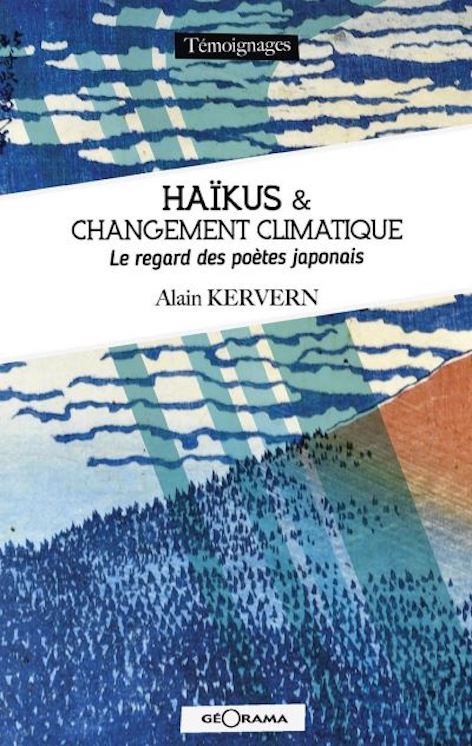
Depuis son article en 2009 pour le magazine Psychologies, la journaliste Pascale Senk œuvre pour la promotion et la pratique du haiku. Dans sa conférence TedxTalk en 2018, elle démontre avec des exemples classiques et contemporains comment le haiku est présent dans le quotidien de tous, de l’ennui du travail en open space aux tragédies intimes (rupture amoureuse) et collectives (attentats du Bataclan).
Elle produit aussi le seul podcast francophone dédié au haiku, «17 syllabes, tout sur le Haiku». Enfin, elle vient de publier son recueil de haiku, Ciel changeant, haiku du jour et de la nuit aux éditions Leduc.
Le ghazal persan
Ghazal signifie à la fois conversation amoureuse et biche gracieuse, on lui doit le mot gazelle en français. Le ghazal est essentiellement de la poésie amoureuse et mystique. Il se présente sous forme de couplet ou distique (deux vers) suivi d’autres couplets indépendants (jusqu’à 15) mais qui sont reliés entre eux par la répétition du dernier mot du premiers vers.
Sophistiqué
Les ghazals atteignent un niveau de sophistication et d’ambigüité (profane ou sacré ? l’être aimé est-il un homme, une femme, ou Dieu ?) qui font de leur étude et interprétation une discipline quasi herméneutique. Mais dans le monde persan (Iran et Afghanistan) et ourdou (Inde et Pakistan), les ghazals sont l’affaire de tous, surtout ceux de Hafez.


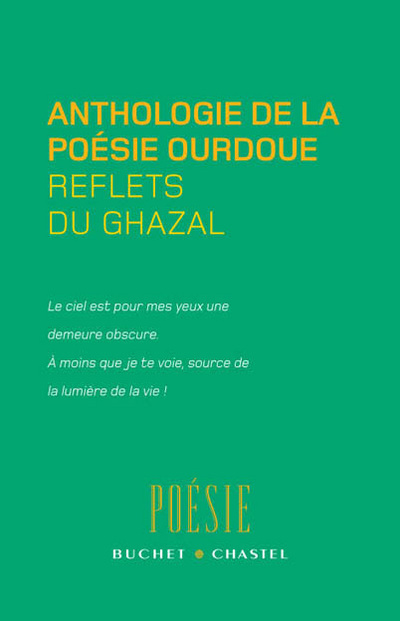
Populaire
L’écrivain suisse Nicolas Bouvier le constate de façon surprenante lors son voyage en Iran en 1953, dont il tire son chef-d’œuvre, L’usage du monde, qu’il fera paraitre 10 ans plus tard.
Cette méthode ne suffit pas : impossible de parquer sa voiture sans voir surgir une sorte d’escarpe qui prétende la «garder» pour un demi toman. Mieux vaut accepter, sans quoi votre gardien, déçu, risque bien de dégonfler les pneus en votre absence ou de disparaître avec la roue de secours en direction du Bazar, où vous pourrez aller la racheter. En somme, c’est d’eux mêmes qu’ils s’offrent à vous préserver. Au début nous refusions; nous étions serrés; un toman comptait. On se disait aussi : notre voiture est trop minable. Un jour nous l’avons retrouvée en plein milieu du trottoir. Ils avaient dû s’y mettre à six, dans un concours de badauds et dans les rires, pour lui faire franchir le caniveau. À cet incident près, les voleurs l’ont toujours ménagée; sans doute à cause du quatrain de Hafiz que nous avions fait inscrire en persan sur la portière de gauche :
Même si l’abri de ta nuit est peu sûr
et ton but encore lointain
sache qu’il n’existe pas
de chemin sans terme
Ne sois pas triste. [Ghazal 250.8. Le divan, Hafiz.]L’usage du monde, Nicolas Bouvier.
Pendant des mois cette inscription nous servit de Sésame et de sauvegarde dans des coins du pays où l’on n’a guère sujet d’aimer l’étranger. En Iran, l’emprise et la popularité d’une poésie assez hermétique et vieille de plus de cinq cents ans sont extraordinaires. Des boutiquiers accroupis devant leurs échoppes chaussent leurs lunettes pour s’en lire d’un trottoir à l’autre. Dans ces gargotes du Bazar qui sont pleines de mauvaises têtes, on tombe parfois sur un consommateur en loques qui ferme les yeux de plaisir, tout illuminé par quelques rimes qu’un copain lui murmure dans l’oreille. Jusqu’au fond des campagnes, on sait par cœur quantité de «ghazal» (17 à 40 vers) d’Omar Khayyâm, Saadi, ou Hafiz. Comme si, chez nous, les manœuvres ou les tueurs de La Villette se nourrissaient de Maurice Scève ou de Nerval. Parmi les étudiants, les artistes, les hommes de notre âge, ce goût tournait souvent à l’intoxication. Ils connaissaient par cœur centaines ces strophes fulgurantes qui abolissent le monde en l’éclairant, prêchent discrètement l’identité finale du Bien et du Mal et fournissent au récitant – ongles rongés, mains fines serrées sur un verre de vodka – les satisfactions dont son existence est si chiche. Ils pouvaient se relayer ainsi des heures durant, vibrant «par sympathie» comme les cordes basses du luth, l’un s’interrompant pour dire qu’il songe à se tuer, l’autre pour commander à boire ou nous traduire un couplet. La musique du persan est superbe, et cette poésie nourrie d’ésotérisme souphi, une des plus hautes du monde.
Les ghazals de Hafez sont toujours aussi populaires aujourd’hui, comme me l’explique Niusha Z., Canadienne-Iranienne. Avec humour, elle affirme qu’il est plus courant pour les Iraniens d’ouvrir le Diwan que le Coran !
Devant une décision à prendre, un choix à faire, un ghazal de Hafez lu au hasard contiendrait la réponse pour qui sait l’interpréter. Bref, Hafez tient lieu d’horoscope.
Le Ghazal contemporain
Il y a plusieurs règles de composition d’une série de ghazal. Voici la règle principale : le dernier mot ou groupe de mot du premier vers doit se répéter à la fin du deuxième vers du premier couplet et des suivants.
Aragon s’y est essayé dans son recueil Le fou d’Elsa, en écorchant peu les règles.
Je suis rentré dans la maison comme un voleur
Déjà tu partageais le lourd repos des fleurs au fond de la nuitJ’ai retiré mes vêtements tombés à terre
J’ai dit pour un moment à mon coeur de se taire au fond de la nuitJe ne me voyais plus j’avais perdu mon âge
Nu dans ce monde noir sans regard sans image au fond de la nuitDépouillé de moi-même allégé de mes jours
N’ayant plus souvenir que de toi mon amour au fond de la nuitMon secret frémissant qu’aveuglement je touche
Mémoire de mes mains mémoire de ma bouche au fond de la nuitLong parfum retrouvé de cette vie ensemble
Et comme aux premiers temps qu’à respirer je tremble au fond de la nuitTe voilà ma jacinthe entre mes bras captive
Qui bouges doucement dans le lit quand j’arrive au fond de la nuitComme si tu faisais dans ton rêve ma place
Dans ce paysage où Dieu sait ce qui se passe au fond de la nuitOu c’est par passe-droit qu’à tes côtés je veille
Et j’ai peur de tomber de toi dans le sommeil au fond de la nuitComme la preuve d’être embrumant le miroir
Si fragile bonheur qu’à peine on peut y croire au fond de la nuitJ’ai peur de ton silence et pourtant tu respires
Contre moi je te tiens imaginaire empire au fond de la nuitJe suis auprès de toi le guetteur qui se trouble
A chaque pas qu’il fait de l’écho qui le double au fond de la nuitJe suis auprès de toi le guetteur sur les murs
Qui souffre d’une feuille et se meurt d’un murmure au fond de la nuitJe vis pour cette plainte à l’heure ou tu reposes
Je vis pour cette crainte en moi de toute chose au fond de la nuitVa dire ô mon gazel à ceux du jour futur
Gazel du fond de la nuit. Le fou d’Elsa, Louis Aragon. Editions Seghers
Qu’ici le nom d’Elsa seul est ma signature au fond de la nuit !
La contrainte de répétition dans une série de ghazals crée un collier de perles poétiques et polysémiques, car répéter le même mot ne veut pas dire qu’on parle de la même chose.
C’est évident dans ce ghazal de la poète américaine Marylin Hacker, où for it, désigne à chaque fois une chose différente.
The moment’s motion blurs the pose you hold for it
as if you knew what future were foretold for it.Is there a course in loss and cutting losses,
and what ought I to do to be enrolled for it?I could walk to the canal and watch the barges
from the footbridge, but this morning it’s too cold for it.However the diplomat flattered the dictator
or threatened him, ten prisoners were paroled for it.Who wants to push poems on reluctant readers?
Keep them in notebooks, wait to be cajoled for it.A lover’s hand reaches for the beloved’s
hand, as yours would too. Are you too old for it?Yâ ‘ainy, if revolution shakes your stupor
Ghazal two, Marylin Hacker
awake, open your eyes, your arms, be bold for it!
Le poète palestinien Mahmoud Darwich (1941-2008) s’inspire du ghazal dans son recueil Dans le lit de l’étrangère.
Avec la coupe sertie d’azur,
Attends-la
Auprès du bassin, des fleurs du chèvrefeuille et du soir,
Attends-la
Avec la patience du cheval sellé pour les sentiers de montagne,
Attends-la
Avec le bon goût du prince raffiné et beau,
Attends-la
Avec sept coussins remplis de nuées légères,
Attends-la
Avec le feu de l’encens féminin partout,
Attends-la
Avec le parfum masculin du santal drapant le dos des chevaux,
Attends-la.
Et ne t’impatiente pas. Si elle arrivait après son heure,
Attends-la
Et si elle arrivait, avant,
Attends-la
Et n’effraye pas l’oiseau posé sur ses nattes,
Et attends-la
Qu’elle prenne place, apaisée, comme le jardin à sa pleine floraison,
Et attends-la
Qu’elle respire cet air étranger à son cœur,
Et attends-la
Qu’elle soulève sa robe qu’apparaissent ses jambes, nuage après nuage,
Et attends-la
Et mène-la à une fenêtre, qu’elle voit une lune noyée dans le lait,
Et attends-la
Et offre-lui l’eau avant le vin et
Ne regarde pas la paire de perdrix sommeillant sur sa poitrine,
Et attends-la
Et comme si tu la délestais du fardeau de la rosée,
Effleure doucement sa main lorsque
Tu poseras la coupe sur le marbre,
Et attends-la
Et converse avec elle, comme la flûte avec la corde craintive du violon,
Comme si vous étiez les deux témoins de ce que vous réserve un lendemain,
Et attends-la
Et polis sa nuit, bague après bague,
Et attends-la
Jusqu’à ce que la nuit te dise :
Il ne reste plus que vous deux au monde.
Alors, porte-la avec douceur vers ta mort désirée
Et attends-la…!
Mahmoud Darwich, Dans le lit de l’étrangère, Actes Sud, 2000. Traduit par Elias Sanbar.
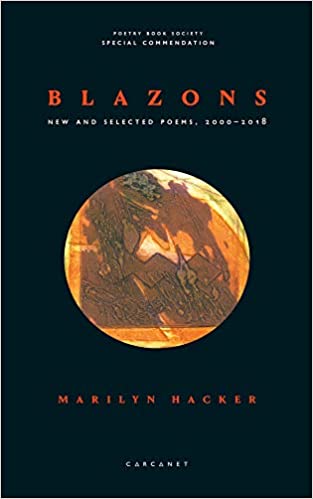

Le sijo coréen
Contrairement au haiku dans sa forme la plus traditionnelle, le sijo coréen ne s’empêche pas de parler d’amour. Il est aussi un peu plus long et moins contraignant que son voisin nippon.
Dans la littérature coréenne, court poème de 3 vers comptant chacun 3 groupes de syllabes : 3-4-3 / 3-4-3 / 3-5-4. On trouve les premiers sijo chez U T’ak (1262-1342) de la dynastie de Koryo, mais c’est pendant la dynastie des Yi que ce genre connaîtra son âge d’or. Le plus grand auteur de sijo est la poétesse Hwang Chin-i, qui vécut sous le règne du roi Chungjong (1506-1544). Forme poétique la mieux adaptée à la sensibilité coréenne classique, le sijo (« air populaire ») a eu du succès aussi bien dans le peuple qu’au sein de l’élite.
Dictionnaire mondial des littératures, Karen Haddad-Wotling et Pascal Mougin. Larousse, 2002, p.201
Quelques sijo
Je coupe en deux la longue nuit de novembre.
Glisse une moitié sous la couverture printanière.
Quand il viendra, je la déroulerai pouce après pouce, pour rendre la nuit plus longue.
Hwang Jini
La nuit s’installe sur la rivière
Prince Wolsan
Les ondelettes sont froides
J’envoie une ligne par le fond
Ça ne mord pas
Je rame au retour dans ma barque vide
Sous une lune sans coeur
Les feux sur les collines printanières
Kim Tok-Jyong
Ont détruit les fleurs en bouton
Nous avons de l’eau pour éteindre ces feux
Mais le feu sans fumée qui brûle mon coeur
Aucune eau ne peut l’éteindre
La daina lettonne
La daina de Lettonie est une poésie ancrée dans le folklore et le chant. La Lettonie est parmi les derniers pays européens à devenir chrétien (début du 13 siècle), ce qui explique pourquoi le paganisme balte a perduré dans la culture populaire. Il suffit de lire un recueil de dainas pour s’en rendre compte (ou mieux, aller en Lettonie). J’ai consacré un article aux dainas ici.
Le landay afghan
Le landay afghan (pachto d’origine) se compose de 22 syllabes réparties en deux vers de 9 et 13 syllabes dont les rimes finissent en ma ou na.
Le landay, qui signifie petit serpent venimeux en pachto, n’est pas une poésie orale spécifique aux femmes. Par la force des choses, il est devenu leur seule forme d’expression artistique relativement accessible, même si ce n’est pas sans danger. J’y ai consacré un article ici.
Pour aller plus loin
Mon article sur le haiku publié dans le magazine La Rumeur du Loup
Le haiku selon Barthes. Philippe Vercaemer in Modernités #10. Poétiques de l’instant. 1998. p.131-149.
Pourquoi les non Japonais écrivent-ils des haikus ? Alain Kerven. La part commune, 2010
Petit manuel pour écrire des haiku, Philippe Costa. éditions Phillipe Picquier, 2000
Éphémère : 88 plaisirs fugaces. Anthologie établie par Thierry Renard et Bruno Doucey. Editions Bruno Doucey, 2022.
Le Divan, Hafez de Chiraz. Verdier poche, 2006.
L’âme poétique persane : Ferdowsî, Khayyâm, Rûmi, Sa’adî, Hâfez. Daryush Shayegan. Albin Michel, 2017.
L’usage du monde. Nicolas Bouvier, La découverte, 2014.
Blazons: New and Selected Poems, 2000–2018, Marylin Hacker. Carcanet, 2019
Les Hain-Teny Merinas: Poésies populaires malgaches. Recueillies et traduites par Jean Paulhan. Préface à la nouvelle édition de Bernard Baillaud. P. Geuthner, 2007. (reproduction en fac-similé de l’édition de 1913)
Hainteny d’autrefois , poèmes traditionnels malgaches recueillis au début du règne de Ranavalona I, 1828-1861. Haintenin’ ny fahiny, voaangona tamin’ ny voalohandohan’ ny nanjakan-dRanavalona I. Edition et traduction de Bakoly Domenichini Ramiaramanana. Tananarive Librairie Mixte, 1971.
La traduction de Hain-Teny, une poésie traditionnelle malgache, Naivoharisoa Patrick Ramamonjisoa. Thèse de maitrise, York University, 2005. 184 pages.
Paroles de Kabary : hain-teny, ohabolana, fitenenasa gasy : une anthologie de la parole poétique à Madagascar. Édité par Nicolas Gérodou, illustré par Chloé Robert. Éditions Poisson rouge.oi, 2015
Hain-Teny et Haiku un article de Magali Bossi, « Hain-teny et haïku. Détours et cheminements de Jean Paulhan », Fabula / Les colloques, Traduire, transposer, composer. Passages des arts verbaux extra-occidentaux en langue française
Sur le Limerick : Poèmes sans sens / Nonsense poems. Edward Lear. Traduction et préface par Henri Parisot, illustrations par Edward Lear. Édition bilingue. Aubier-Flammarion, 1974.
https://www.theguardian.com/books/2020/jan/13/poem-of-the-week-ghazal-myself-by-marilyn-hacker
https://www.recoursaupoeme.fr/le-haiku-francophone-contemporain/



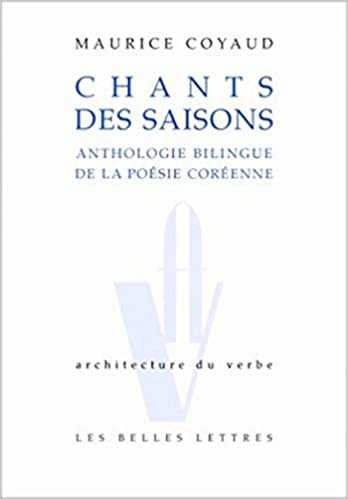
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.